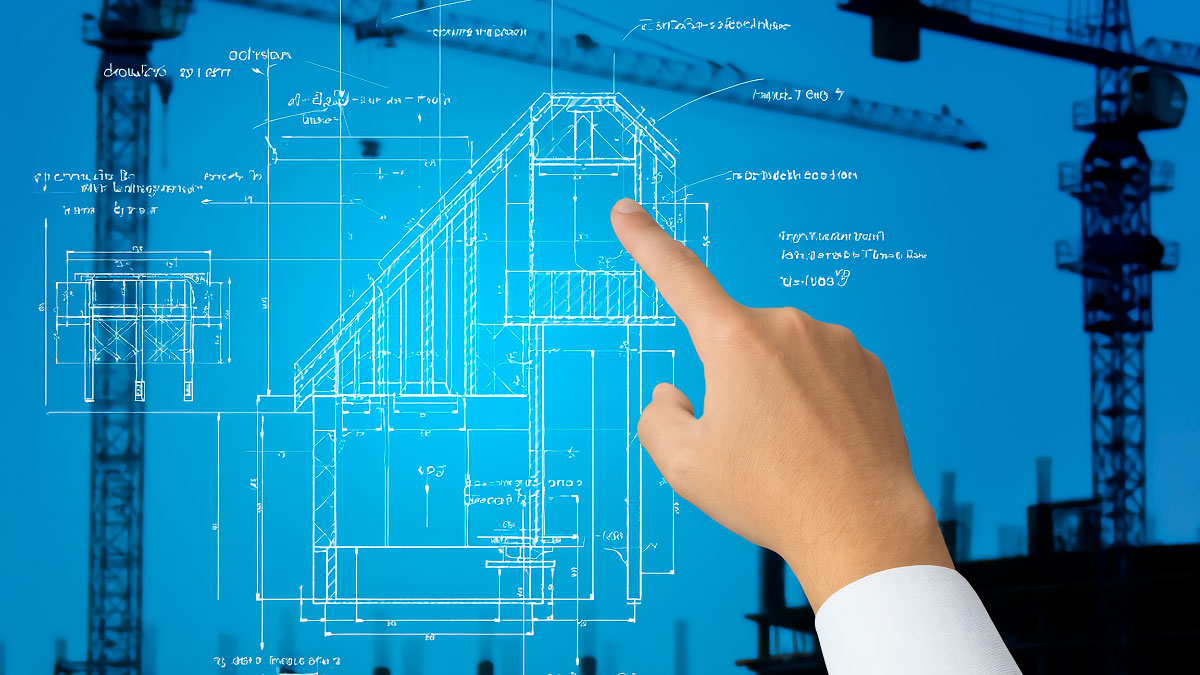La solidité structurelle et la gestion proactive des risques sont, entre autres, deux des piliers fondamentaux de l’exercice de l’architecture et de la construction. En conséquence, le rapport de l’ingénieur structurel, qui fournit une analyse exhaustive de la solidité, de la sécurité et de l’intégrité d’un bâtiment, est un document technique indispensable.
Ce document a pour objectif principal d’évaluer l’état d’une structure et, lorsque cela est nécessaire, de proposer des solutions, corrections ou améliorations. Son utilité se manifeste dans de multiples contextes : par exemple, lors de transactions immobilières, il certifie auprès des acheteurs et des vendeurs la stabilité de l’immeuble ; également, avant d’entreprendre des travaux de rénovation importants, le rapport permet de comprendre l’état structurel et la nécessité —ou non— de renforcements.
Par ailleurs, autre preuve de son utilité, les compagnies d’assurance exigent souvent ce rapport structurel après des événements naturels comme des tempêtes ou des séismes, afin de quantifier les dommages et d’accélérer les demandes d’indemnisation. Dans d’autres cas, il est essentiel pour attester de la conformité aux réglementations locales de construction et aux normes de sécurité.

Pour son élaboration, on combine des visites sur site, des inspections visuelles, des simulations informatiques et des analyses de matériaux. Des facteurs tels que les dimensions du bâtiment, sa complexité architecturale, l’accessibilité des éléments structurels ou son état de conservation influencent le temps et le coût du processus. Les bâtiments anciens ou endommagés, par exemple, nécessitent généralement des évaluations plus minutieuses.
Le rapport structurel se conclut par un cachet professionnel qui certifie sa validité et engage la responsabilité de l’ingénieur structure.
Par Raúl Soriano, modélisateur senior au Département d’Architecture d’Amusement Logic